Les acouphènes, ces bruits (sifflements, bourdonnements, grincements…) perçus sans source sonore extérieure, concernent aujourd’hui près de 8 millions de personnes en France, dont 30 % vivent une gêne importante dans leur vie quotidienne, familiale ou professionnelle
Une définition en pleine évolution
Longtemps considérés comme de simples « bruits fantômes », les acouphènes sont aujourd’hui mieux compris comme une expérience sensorielle, émotionnelle et cognitive complexe, propre à chaque individu. Ils sont souvent le résultat d’un dysfonctionnement du système auditif, mais aussi de l’activité neuronale du cerveau qui tente de compenser une perte auditive
Une illusion sonore produite par le cerveau
Dans la majorité des cas, les acouphènes dits « subjectifs » sont liés à une perte auditive. Le cerveau, face à ce manque de signaux, augmente spontanément son activité, générant alors un son perçu, sans cause externe. Ce mécanisme, censé être une adaptation, peut devenir un véritable « bug auditif ».
Des origines multiples
Les causes peuvent être très variées : perte auditive liée au vieillissement, otites, traumatisme sonore, bruxisme (grincement des dents), stress, fatigue… Il existe même des acouphènes somato-sensoriels, influencés par les mouvements de la mâchoire ou du cou.
Des traitements encore limités, mais en progrès.
Il n’existe pas de traitement miracle pour supprimer les acouphènes subjectifs. En revanche, des approches pluridisciplinaires (sophrologie, aides auditives, thérapies sonores, TCC, neuromodulation, etc.) visent à mieux vivre avec. La recherche explore également de nouvelles pistes pharmacologiques, encore expérimentales.
Vers une prise en charge globale
La prise en compte des dimensions émotionnelles et psychologiques est désormais essentielle. Cela ouvre la voie à des approches complémentaires comme la sophrologie, qui aide à apaiser le stress, améliorer le sommeil et réduire l’impact émotionnel des acouphènes.
Notes et sources:
- Unité CNRS/Aix-Marseille Université.
- https://doi.org/10.1016/bs.pbr.2021.01.029(link is external)
- Notons qu’une étude de 2023 suggère que ce pourcentage pourrait être bien plus élevé car même si aucun déficit n’est retrouvé à l’audiogramme, il peut exister des lésions indétectables des fibres nerveuses auditives : : https://doi.org/10.1038/s41598-023-46741-5(link is external)
- https://www.larevuedupraticien.fr/article/acouphenes-subjectifs
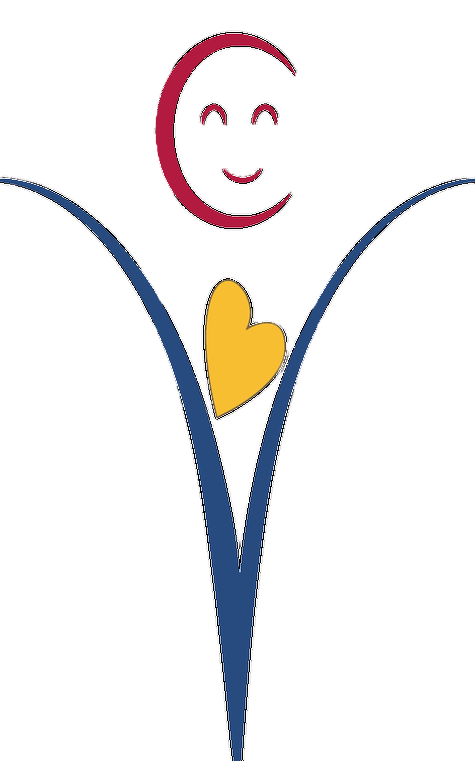
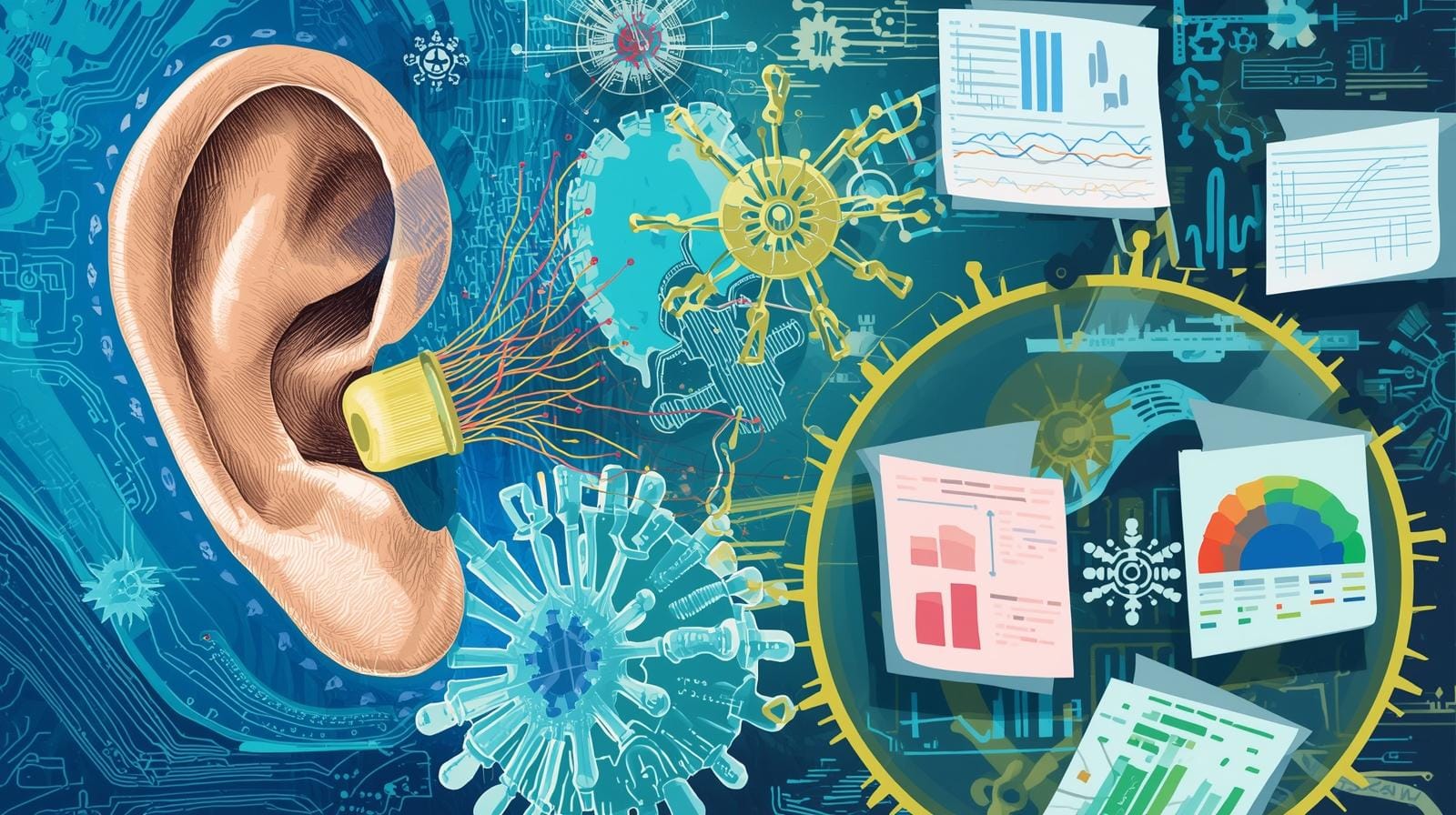
Laisser un commentaire